
Le spectateur impatient
par Gérard Mordillat *
Un article du Monde Diplomatique

Au CINÉMA, le spectateur contemporain est un homme ou une femme pressé. Il faut
que l'action s'engage dès la première image du film, que les séquences
s'enchaînent à la vitesse d'une mitrailleuse lourde, que les plans se succèdent
au rythme du battement d'ailes d'un colibri. Le spectateur contemporain est un
enfant gâté qui pleure et trépigne si son moindre désir d'images et de sons
n'est pas immédiatement exaucé, et qu'il faut d'urgence faire taire en lui
plantant une tétine dans la bouche ou en le distrayant avec un hochet (voire les
deux). Osons dire qu'une majorité de films sont aujourd'hui produits sous les
auspices de la tétine et du hochet, c'est-à-dire du Dolby Stéréo à la
puissance dix et des effets spéciaux en images de synthèse pour mettre en scène
catastrophes nucléaires, guerres intersidérales, épidémies mortelles. monstres
et surnaturel.
Le cinéma s'est transformé en une lampe qui s 'allume et s'éteint, un miroir tournant semblable à celui que Franz Mesmer utilisait pour hypnotiser ses patients. Il s'agit d'en mettre plein les yeux au spectateur pour qu'il n'y voie plus rien; de lui en mettre plein les oreilles pour qu'il n'y entende plus rien. Comme Baruch Spinoza le pressentait : « Plus il y a de choses auxquelles est jointe une image, plus souvent elle devient vive. Plus il y a de choses en effet auxquelles une image est jointe, plus il y a de causes pouvant l'exciter» (Éthique). Au nom de l'impatience, la sensation règne, et l 'intelligence comme l'émotion disparaissent.
Yves Robert racontait que René Clair tournait peu de prises par plan : une première, rarement une seconde. Sur Les Grandes Manoeuvres, avec Gérard Philipe, après une deuxième prise, quelle ne fut pas la surprise des acteurs en entendant le réalisateur commander : « On la refait !» Ils l'interrogèrent pour savoir ce qui n'allait pas. La réponse tomba sèchement : « Jouez plus vite!» Le film - en anglais movie ( de moving : « en mouvement») - repose sur un art du rythme comparable à la composition musicale. Mais ce tempo, ce mouvement qui est le film lui-même, opère soit à l'intérieur du cadre conduit par le jeu des acteurs, soit par la durée du plan. Laquelle se raccourcit sans cesse : douze secondes en moyenne en 1930, deux secondes et demie, voire moins, aujourd'hui (1). Le «jouez plus vite!» a été· confisqué aux acteurs et entièrement confié à la prise de vues et au montage. L'inflation des plans symbolise la richesse de l'image, l'abondance, l'opulence visuelle. Le spectateur doit en avoir pour son argent, tout comme le pop-corn qu'il dévore pendant la séance doit lui être servi dans d'énormes récipients. L'effet est paradoxal, puisque si, en apparence, cette manne tombée de l'écran comble l'impatience du spectateur, elle le garde en réalité à distance de ce qui se joue, déréalise et édulcore ce qu'il voit. Ainsi la violence qui s'exprime dans nombre de films ( et dans les jeux vidéo) devint-elle un artefact de cette violence, une coquetterie décorative où le sang gicle, où les coups pleuvent en feu d' artifice sans que la douleur, la souffrance, l'horreur coupent l'appétit du spectateur.
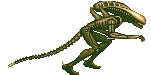
Les évolutions techniques, notamment l'usage intensif au cinéma comme à la télévision du Steadicam (un système stabilisateur qui permet de faire des travellings fluides, sans à-coups, caméra à la main dans n'importe quel décor), placent le spectateur « au coeur de l'action». Mais, dès lors, ce dernier ne voit plus l'action dans laquelle il se trouve immergé. Il perd tout recul, dominé par la sensation que l'image lui procure. Transposée sur le plan politique, cette domination fait du spectateur impatient un citoyen prisonnier de l'image et un consommateur gavé au sucre de la nouveauté. Un citoyen qui ne réclame plus de voir ni de comprendre (l'idéologie, les programmes), mais d'être ébloui par l'image projetée par le politique ( chaque semaine, la critique vante un nouveau film «éblouissant»).
Cinématographiquement et politiquement, cela peut s'assimiler à un tour de bonneteau, puisqu'il s'agit de distraire le gogo (le spectateur, l'électeur) tandis que les cartes voltigent sur la table comme les plans sur l'écran. À tous les coups on perd. Et le cinéma se perd lorsqu'il se transforme en grand huit ou en train fantôme ( et ne parlons pas de la politique). Quant aux dialogues ( ou aux discours), les plus courts sont les meilleurs, et la «petite phrase», le tweet, le slogan prospèrent. Lors du tournage de son dernier James Bond, Roger Moore répondit avec malice à un journaliste l'interrogeant sur l'événement le plus extraordinaire du film: « J'aurai une réplique de deux lignes !»
Le cinéma, dans son expression la plus authentique, la plus profonde, est un art contemplatif. Mais quel studio risquerait aujourd'hui 1 euro ou 1 dollar sur Playtime, de Jacques Tati ; 2OO1 : l'odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick; The Party, de Blake Edwards ; Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan; les films d 'Andreï Tarkovski ; voire Les Communiants, d'Ingmar Bergman, qui commencent par une messe protestante d'au moins cinq minutes ! Ces films-la qui nous apprennent à voir, à entendre, qui suscitent -notre regard, travaillent le temps et l'espace sans jamais chercher à nous vendre des savonnettes, disparaissent des écrans. On nous explique que ce cinéma qui se mérite, qui réclame une attention soutenue, qui allume le corps et l'esprit, repousserait le spectateur. Quand le tempo ne bat pas assez vite, les commentateurs et les studios font chorus : il y a des longueurs ! Et la longueur - la digression: le sens de l'espace et du temps - est le grand Satan du spectateur contemporain; un diable qui le fait fuir des sa1les avant de l'éloigner des écrans de télévision.
IL EXISTE néanmoins deux domaines télévisuel et cinématographique où le temps n'est pas compté : la retransmission intégrale des étapes du Tour de France comme le notait Jean Luc Godard « le seul moment où l'on voit les hommes travailler » et les films pornographiques où les accouplements doivent suffisamment durer pour que, à l'instar des cours de gym matinaux, le téléspectateur ait l'idée et le temps de les imiter …
Ce spectateur impatient est une création des publicitaires; du désir mortifère de vendre. Et, pour vendre, il faut faire saliver et distraire. La méthode est aussi simple que le dressage du chien d'Ivan Pavlov: on exhibe un instant le produit ( superproduction ou candidat à l'élection), le spectateur ou le citoyen, comme le chien, salivent, puis on le soustrait aussitôt à leur regard pour provoquer frustration et désir. Ce qui vaut pour n'importe quel produit alimentaire, ménager ou de service vaut désormais de la même manière pour le cinéma, la télévision et le politique.
Cette impatience élevée à la dignité de vertu cardinale reflète aussi l'emprise du management contemporain. Fini les pauses, les temps morts, la réflexion sur et au travail. Au nom de la sainte productivité, l'homme ou la femme à la tâche ne doit pas lever le nez de la journée, de même qu'il ne doit pas quitter l'écran des yeux (l'écran du cinéma - obligation publicitaire -, celui de son ordinateur - obligation de rendement). Le salarié, le citoyen et le spectateur sont dressés à l'urgence.
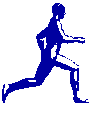
Le diable des programmateurs de télévision, c'est la zappette. Cet infernal instrument qui, au grand désespoir des annonceurs publicitaires ( et des responsables politiques), permet de changer de chaîne sans quitter son canapé. Mais, quoi qu'ils fassent, le téléspectateur contemporain - cet impatient chronique - change de chaîne sans arrêt, comme s'il lui était insupportable de rester devant la même image, de la voir, de l'analyser, d'en jouir. Il ne veut surtout rien rater de ce qui se passe sur les autres chaînes; ne serait-ce que pour amortir l'abonnement aux 325 canaux des programmes. Il lui faut tout voir et, en voyant tout, ne plus rien voir, ne plus rien entendre, ne plus rien comprendre sinon la pub ( images et messages), axe central et colonne vertébrale de toutes les politiques éditoriales des chaînes privées et publiques. M. Patrick Le Lay (patron de TF1) avait fait scandale en affirmant que sa tâche de diffuseur était de « rendre disponible» le cerveau du téléspectateur, « c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages». Pour une fois qu'un responsable de chaîne parlait sans détour, on aurait dû l'applaudir, au moins pour sa franchise.
Cette impatience qui semble habiter le spectateur contemporain est le signe de son angoisse devant la montée des guerres sur tous les continents, devant le péril climatique, devant la pauvreté endémique, devant la mort. Il faut que tout aille vite, qu'il s'en mette le plus possible dans les yeux (plein la lampe l), qu'il avale le plus d'images, le plus d'histoires possibles avant« les derniers jours de l'humanité » (Karl K.raus ). Il est d'ailleurs symptomatique que tant de films racontent la fin du monde. À l'époque de l'apôtre Paul, les Thessaloniciens convaincus de connaître la fin des temps de leur vivant étaient dans le même état d'esprit. Redoutant que tout s'achève demain, au grand regret de Paul, ils se livraient à une débauche éperdue, buvaient jusqu'à plus soif, ne travaillaient plus, riaient et dansaient, attendant le dernier instant. Pour le spectateur contemporain - comme pour le Thessalonicien des années 50 de notre ère-, il faut tuer le temps. Dieu est mort, et, aujourd'hui, comment mieux tuer le temps que devant un écran face au défilement inexorable des images annonciatrices de l'apocalypse ?
* Écrivain et cinéaste, auteur de La tour abolie, Albin Michel, Paris 2017, et du film Mélancolie ouvrière qui sera diffusé sur Arte le 24 août 2018.